La voiture en ville : un sujet de polarisation, mais des espaces de conciliation possibles
Mouvement des gilets jaunes nourri par la hausse des carburants, contestation des 80km/h, critique des ZFE…depuis près d’une décennie, la voiture est au cœur des conflits sociaux et des polémiques dans notre société. Elle est devenue un objet de tensions, un marqueur de clivage idéologique profond et un symbole de l’opposition « peuple/élites » et du backlash écologique en cours. Après la mobilisation des « gueux », sous l’égide d’Alexandre Jardin, contre les ZFE, et le recul du politique sur ce sujet, l’étude exclusive de Roole, réalisée par l’Institut Bona fidé auprès d’un échantillon représentatif de 1500 Français et de plus de 500 maires, permet de faire le point et de dresser un état des lieux plus nuancé qu’il n’apparaît dans le débat public.
Certes, l’étude confirme que la voiture est bien un objet de clivages et de polarisation. Entre gauche et droite, entre habitants des territoires ruraux et périurbains et habitants des grandes métropoles, entre jeune et seniors, entre non-diplômés et diplômés du supérieur, ou encore entre utilisateurs réguliers de la voiture et personnes ne possédant pas de voitures. Mais elle révèle également que des espaces de conciliation sont possibles, à condition d’avoir une approche territorialisée des politiques de réduction de la place de la voiture, de privilégier la concertation au dogmatisme et de mettre en place des mesures d’accompagnement positives et incitatives, et non stigmatisantes et contraignantes.
Les Français souscrivent ainsi très largement à l’efficacité des politiques de réduction de la place de la voiture en ville pour atteindre des bénéfices collectifs tels que la réduction de la pollution de l’air et des nuisances sonores. Ils se disent majoritairement favorables à la réduction de la place de la voiture dans les grandes métropoles mais s’y opposent dans toutes les autres tailles de ville. Ils considèrent que, là où ils habitent, ces politiques créent des transformations plus négatives que positives, parce qu’elles occasionnent des désagréments et parce que les alternatives à la voiture sont insuffisantes. Ils sont conscients de l’enjeu écologique mais plus sensibles encore à celui du dynamisme des commerces et de l’attractivité des centres-villes. Ils plébiscitent les mesures positives (création de parkings relais, piétonnisation, développement de pistes cyclable…) mais rejettent catégoriquement les mesures punitives, qui, de fait, rendent plus difficile l’accès aux centres-villes (ZFE, hausse du coût stationnement). Ils se prononcent pour la poursuite de ces politiques, à conditions qu’elles soient plus concertées et mieux adaptées aux besoins des habitants du territoire, en résumé qu’elles soient conduites avec un changement de méthode.
Seule institution politique en qui les Français ont encore confiance, les maires reflètent assez fidèlement l’opinion de leurs administrés. Par définition, tout échantillon représentatif de maires est composé très largement de maires de petites et très petites communes. Il porte donc très majoritairement les représentations de ces territoires. Ainsi, au sein de notre échantillon, les maires interrogés soutiennent les politiques de réduction de la place de la voiture en ville dans les grandes métropoles mais s’y opposent ailleurs. Ils sont, comme les Français dans leur ensemble, plus sensibles à l’argument de l’attractivité des centres-villes qu’à celui de l’impératif écologique. Représentants majoritairement des territoires ruraux ou périurbaines, ils s’opposent aux ZFE et se dont largement l’écho du sentiment d’exclusion de leurs administrés. Au-delà des polémiques et des débats, l’étude révèle aussi que pour ces maires l’enjeu de la voiture, sur leur territoire, est d’abord et avant tout un enjeu de sécurité routière.
Les chiffres clés
- 70% des Français et 63% des maires jugent que la voiture sera un enjeu important des prochaines élections municipales.
- 55% des Français approuvent la réduction de la place de la voiture dans les grandes métropoles, 43% dans les villes moyennes, 27% dans les petites villes.
- 66% des maires approuvent la réduction de la place de la voiture dans les grandes métropoles, 47% dans les villes moyennes, 27% dans les petites villes.
- 57% des Français concernés par des politiques municipales de réduction de la voiture en ville jugent négativement les évolutions engagées.
- 60% des Français et 68% des maires estiment que les politiques de réduction de la place de la voiture en ville sont une erreur car elles pénalisent le commerce et l’attractivité des centres-villes.
- 80% des Français sont favorables à la mise en place de parking-relais, à la piétonnisation de rues et de places et à au développement des pistes cyclables.
- 82% des Français sont hostiles à la hausse du coût du stationnement et 75% à la réduction des places de stationnement.
- 42% des Français se sentent exclus et mis à l’écart par les politiques de réduction de la place de la voiture dans le centre des villes.
- 78% des Français et 57% des maires disent ressentir des tensions dans l’espace public entre automobilistes et usagers d’autres moyens de transport.
- 65% des maires se disent opposés aux ZFE.
- 69% des Français jugent que les élus locaux ne sont pas assez à l’écoute de leurs habitants et de leurs besoins dans la mise en place des politiques de réduction de la voiture en ville.
- 78% des maires disent rencontrer dans leur commune des problèmes de sécurité routière (vitesse excessive et/ou trafic trop important).
La méthodologie
Le volet grand public a été réalisé en ligne auprès d’un échantillon de 1 500 Français âgés de 18 ans et plus du 23 au 27 octobre 2025. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas : sexe, âge, profession de la personne interrogées, après startification par région.
Le volet maire a été réalisé en ligne auprès d’un échantillon de 523 laure (78%à et proches collaborateurs (adjoints, conceillers municipaux, DGA, DGS, 22%) du 15 octobre au 5 novembre 2025. L’échantillon a été redressé selon la taille des communes pour coller à la distribution réelle observée sur les 36 000 mairies de France, ce qui garantit une bonne représnetativité des résultats et leur signaficativité satistique.
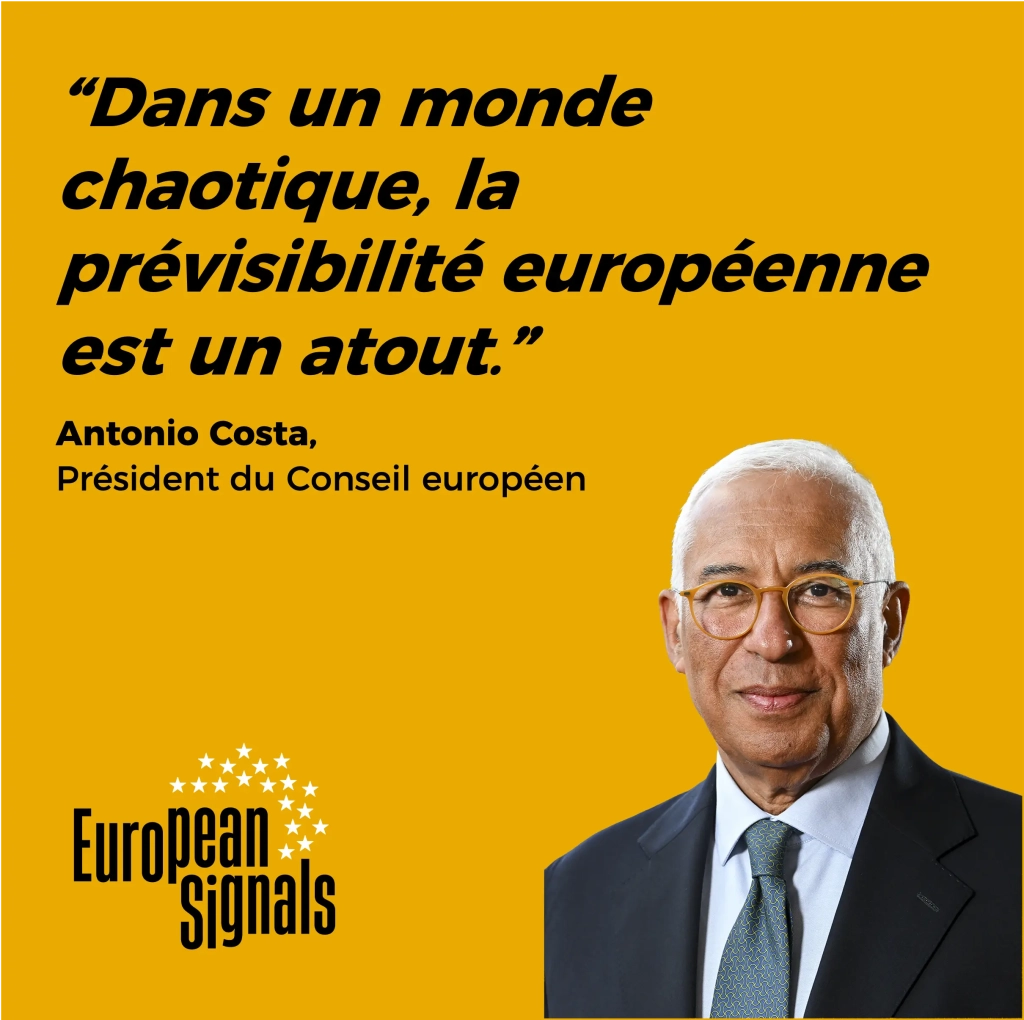
Entretien avec Antonio Costa, Président du Conseil européen

La place de la voiture en ville dans la perspective des municipales – Regards croisés entre les Français et les maires

Moins de compétition, plus de coopération !

Les Français et le Front Républicain
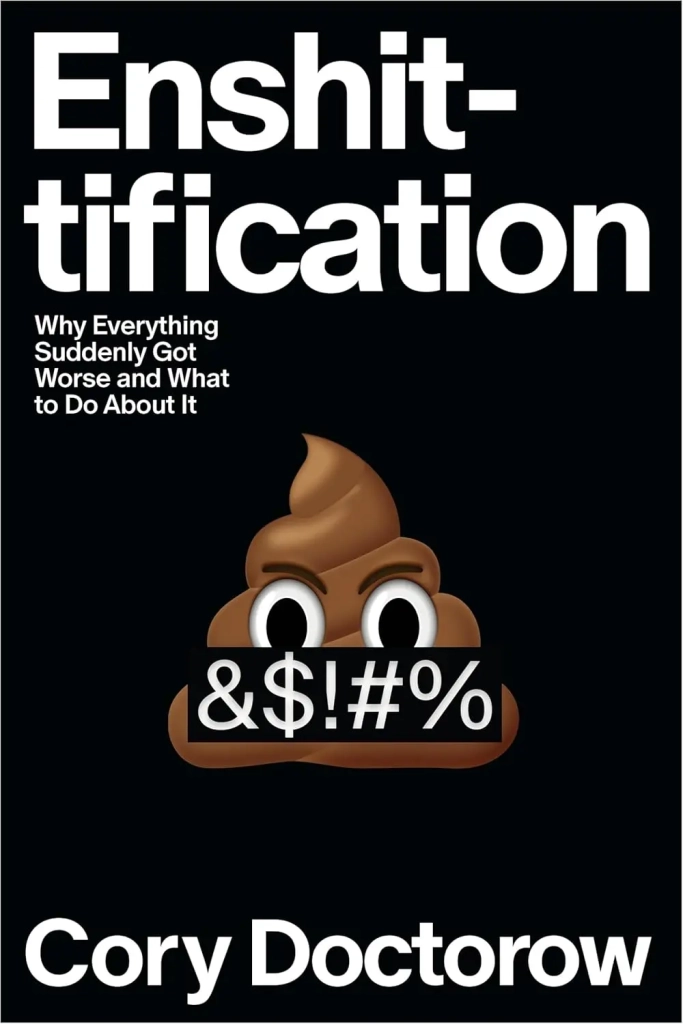
Les Signaux Forts du mois d’octobre
Lisez ici ce que vous ne lirez pas ailleurs

Les Français face au changement et aux transitions

Les Signaux Forts du mois de juillet
Lisez ici ce que vous ne lirez pas ailleurs

Les Signaux Forts du mois de mai
Lisez ici ce que vous ne lirez pas ailleurs