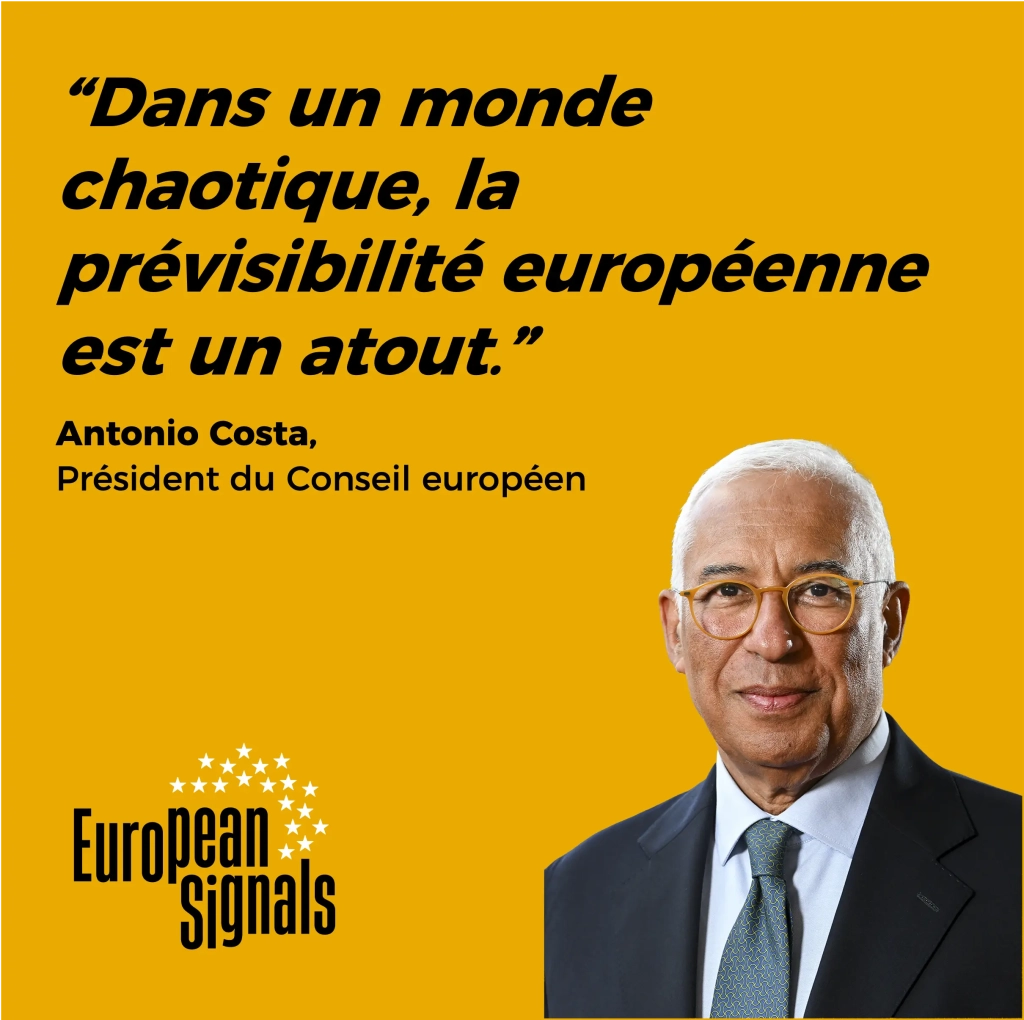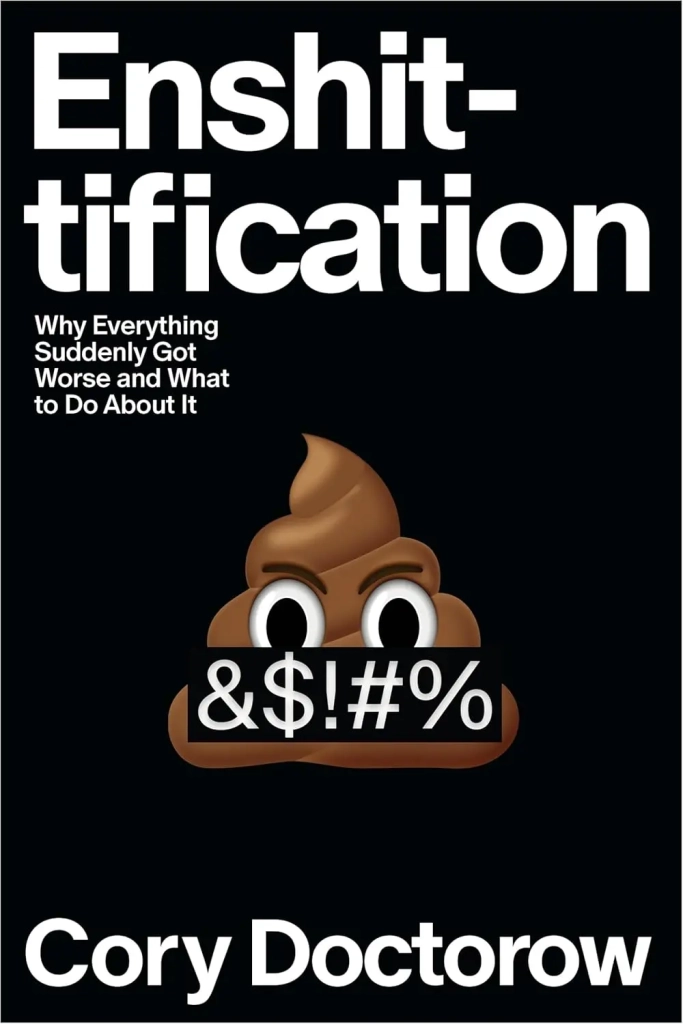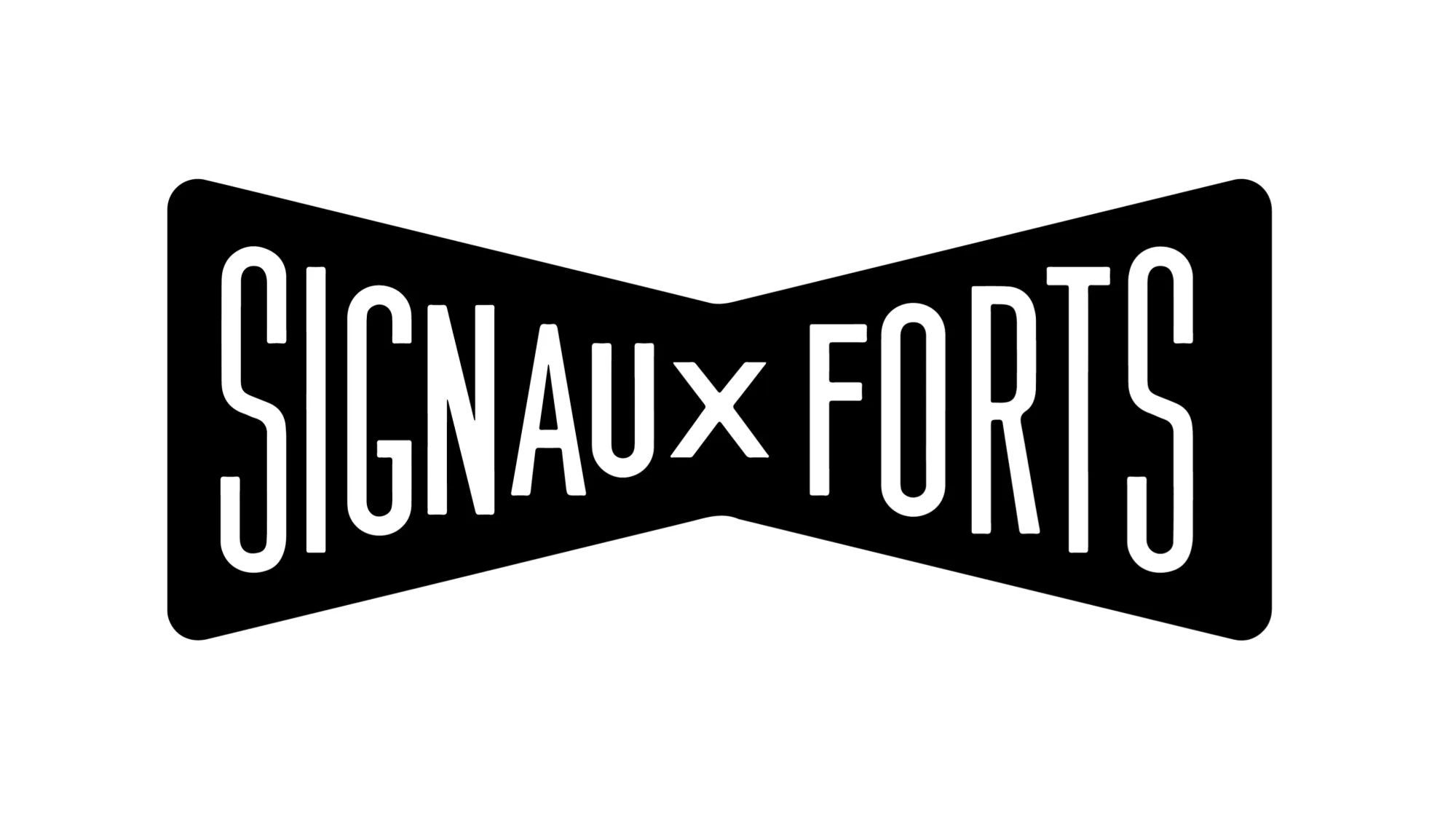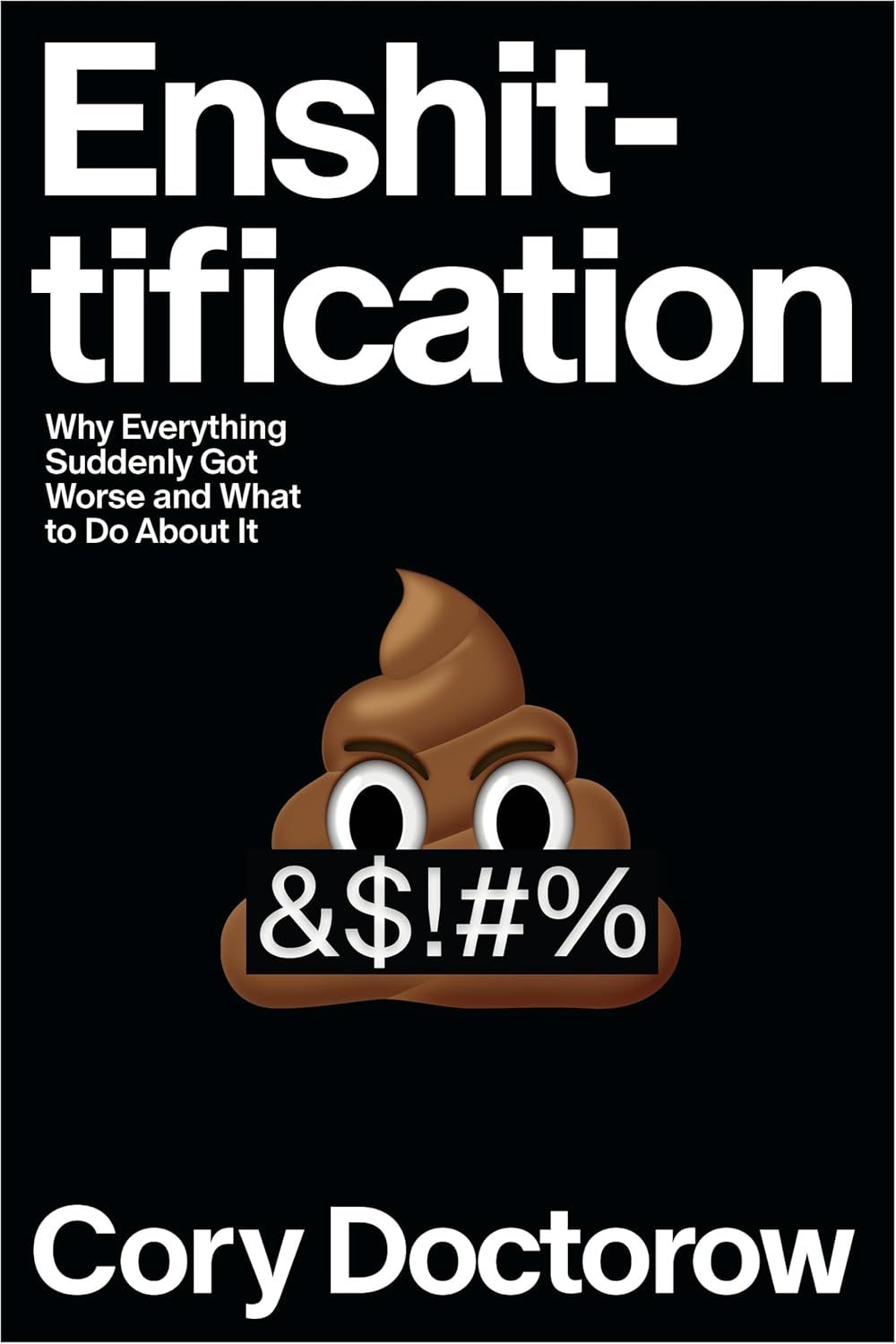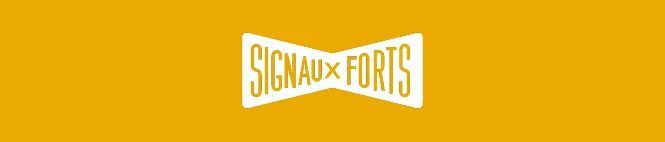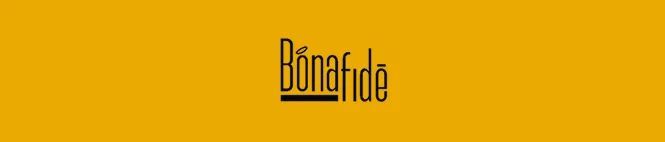Lisez ici ce que vous ne lirez pas ailleurs.
Signaux Forts est la newsletter de l’agence conseil Bona fidé.
Si vous prenez du plaisir à nous lire, n’hésitez pas à transférer cet e-mail et partagez-nous autour de vous ! 👯
|
LE TILT
Merdification : du mot de Cambronne aux maux de la France ?
|
On connaissait déjà le « shit storm », voici, toujours venu des États-Unis, l’«enshittification ». Merdification en français. L’American Dialect Society en a fait le néologisme de l’année en 2023.
Créé à l’origine par Cory Doctorow dans son livre Enshittification. Why everything suddenly got worse and what to do about it, auteur de science-fiction, blogueur, et militant de l’internet libre, le mot s’attachait initialement à décrire la dégradation de service (une merdification progressive) des grandes plateformes numériques, attirant les usagers par des offres gratuites puis les financiarisant au fur et à mesure, une fois pris dans leurs filets. Et à stigmatiser la recherche de rentabilisation maximale de l’audience et le reniement des promesses du début, rendant le service de plus en plus « merdique ». Du Google d’antan à celui d’aujourd’hui, où une demi-douzaine de spams commerciaux surgissent sur votre écran avant de trouver votre requête ; ou du Facebook originel à l’actuel, avec un ratio de 4 pubs pour un message de vos relations ! Aux États-Unis, certains se sont même emparés du concept pour décrire la stratégie internationale de Trump, celle d’asseoir son hégémonie par la vassalisation financière de ses plus anciens alliés, Japon et pays de l’Union européenne. («Enshittification» : la nouvelle doctrine de l’Empire américain | Le Grand Continent). Pour résumer, « l’enshittification », c’est la merdification de la qualité de service par la domination financière.
Une époque de régression
Progressivement, et sans doute parce qu’il rencontrait un ressenti largement dominant chez les citoyens/consommateurs, le concept a fait tache d’huile pour désigner et donner à voir la sensation de dégradation généralisée dans nos rapports aux entreprises (pas toutes évidemment !) et aux organisations dans le monde réel, au-delà du seul numérique. Et ça fonctionne. Pensons une seconde au low-cost aérien, et à sa redoutable et exaspérante capacité à transformer un service gratuit en service payant, la dernière merdification en date consistant désormais à faire payer les valises-cabines, après les bagages en soute, les sièges et le fast-track.
|
En France, personne ne pourra nier sa portée opératoire pour décrire le moment. Délitement des services publics, avec la dégradation de l’accès aux soins et à l’éducation et la déshumanisation de certains services usagers. Merdification du politique, avec la succession des Premiers ministres et des gouvernements et le blocage de l’action à l’Assemblée. Merdification du débat public, entre brutalité, clash et polémiques incessantes. Merdification de la société, avec des interactions sociales de plus en plus tendues et violentes. La liste pourrait être infinie.
Au fond, le terme trouve une popularité et une diffusion grandissantes parce qu’il vient nommer, crûment et sèchement, ce qu’une majorité a le sentiment de vivre : une époque de régression. Dans une étude conduite par l’Institut Bona fidé pour le think tank Synopia (oct. 2025, échantillon représentatif de 1000 Français avec méthode des quotas), la quasi-totalité des transitions en cours sont perçues par l’opinion comme des détériorations, avec un sentiment particulièrement marqué pour l’évolution du système politique et de la démocratie, du système des retraites, du système de santé et de l’éducation (75% des Français perçoivent un changement négatif dans ces secteurs au cours des dernières années). Cette représentation d’un pays en dégradation nourrit des anticipations déclinistes. 62% des Français imaginent à l’horizon 2040 une France plutôt en déclin, 28% en stagnation et 10% seulement en progrès. Les sympathisants du bloc central sont les seuls à ne pas anticiper majoritairement un pays en déclin, préférant imaginer un pays en…stagnation. |
Retrouver le sens du progrès
Cette vision négative du changement au niveau « macro » se décline aussi au niveau « micro ». Six Français sur dix déclarent que les changements et transitions en cours ont un impact « négatif » sur leur vie quotidienne et 55% ont le sentiment de « subir » le changement. Les bas revenus, les retraités et les habitants des zones rurales sont les plus nombreux à ressentir cet impact négatif. La merdification n’est évidemment pas sans conséquences sociales et politiques : la dégradation de la vie quotidienne crée de la frustration, du ressentiment, de la rage et de la colère. Et ne peut être que carburant pour les populismes. Que la merdification soit le terme qui vient de manière évidente éclairer l’époque en dit long sur la nécessité de retrouver au plus vite, individuellement et collectivement, le sens du progrès, et d’un progrès partagé. Une responsabilité impérieuse désormais pour marques, entreprises et institutions politiques.
Le monde est dans la merde. Le pays est dans la merde. Nous sommes dans la merde. La crise morale, culturelle, politique, géopolitique est telle que ce qui était sens commun est en train de se transformer en concept, et en grille de lecture de l’époque. « Quand on est dans la merde jusqu’au cou, il ne reste plus qu’à chanter » disait Beckett dans sa pièce Fin de partie. Chez Bona fidé, nous pensons qu’il y a encore mieux à faire : rouvrir le champ des possibles, trouver des points de vue d’avance, penser de côté pour reconstruire des récits fédérateurs, réinventer des pratiques positives et renouer des liens de confiance entre toutes les parties prenantes.
|
CINÉ CLUB
Sirāt ou le chaos du monde
|
On ne teasera rien de Sirāt pour laisser la surprise à celles et ceux qui ne l’ont pas encore vu, d’un film choc et coup de poing, qui emmène le spectateur dans des endroits et des moments qu’il n’attend pas, et ne peut anticiper. On dira simplement que Sirāt, du réalisateur Olivier Laxe, Prix du Jury à Cannes, est une odyssée profondément nihiliste et sombre, sur le chaos du monde et le délitement du lien social. |
Un film où des personnages décharnés, désincarnés et dés-enchantés dansent toujours seuls, mais ne se parlent plus, ou si peu. Un film où les gens ravent mais ne rêvent plus. Un film où toutes les quêtes paraissent vaines et impossibles. Un film sur la solitude, l’ennui et la fin du collectif. Un film sur un monde sans finalités. Un film, au fond, sur l’absurdité et la merdification du monde. Un film de l’époque, sur l’époque, à voir donc.
|
3 IDÉES ANTI-PRÊT-À-PENSER®
|
Idée #1
Non, l’IA n’est pas forcément un accélérateur
Vaincre le cancer, piloter des missions autonomes vers Mars, doubler notre espérance de vie… Largement diffusé par les acteurs de l’IA eux-mêmes, le refrain est connu : l’IA, c’est le grand accélérateur de la science au XXIe siècle. Pas tant que ça, rétorquent Sayash Kapoor et Arvind Narayanan, chercheurs à Princeton dans leur excellent article « Could AI slow
science ? ». Leur postulat : l’IA a aussi la capacité de ralentir la science.
Selon les auteurs, l’IA exacerbe la malédiction académique du « publier ou périr », à savoir l’obligation pour les scientifiques de publier le plus régulièrement possible les résultats de leurs travaux au sein de revues scientifiques pour gagner en notoriété. En décuplant cette capacité, l’IA accentue ainsi le « paradoxe production-progrès » qui veut que plus on publie, moins on avance. L’IA provoque également un effet « boîte noire » :
elle est capable de « dire ce qui va arriver » à partir des données, mais elle ne fournit pas d’explication causale ou théorique qui permette de comprendre réellement le phénomène. Elle décourage ainsi les remises en question radicales, les disruptions qui font avancer la science. Si le modèle géocentrique avait été boosté par l’IA, notent les auteurs, il aurait certainement retardé l’avènement de la révolution copernicienne. Comme quoi, en science, le raccourci ne fait pas toujours gagner du temps.
« Could AI slow science? » Sayash Kapoor and Arvind Narayanansur sur le blog AINT – AI as Normal Technology
|
Idée #2
Non, la guerre des générations n’a pas lieu
Alors que le 564e épisode de « Gen Z contre Boomers » a connu un certain succès récemment, il est salutaire de lire Janan Ganesh. Selon le subtil chroniqueur du Financial Times, cette guerre des générations – tout comme le concept fictif de « solidarité générationnelle » – n’est qu’un artefact médiatique et politique. Qui a de surcroît le défaut de détourner l’attention des véritables fractures.
Les récentes manifestations au Népal montrent que les inégalités les plus criantes ne sont pas entre « jeunes » et « boomers », mais dressent les « jeunes contre les jeunes » : ceux qui héritent de leurs parents et ceux qui n’héritent rien. Au lieu de se battre contre les générations précédentes fantasmées, Ganesh suggère que l’on s’occupe des inégalités des chances qui travaillent plus que jamais les nouvelles générations.
The young against the young, Janan Ganesh – Financial Times Life & Arts – 27/09/2025 (pour les abonnés)
|
Idée #3
Non, il n’y a pas que « tchik-boom-boom » qui triomphe en streaming
On pourrait penser qu’à l’ère de l’économie de l’attention, les succès sur les plateformes de streaming étaient la chasse-gardée de jeunes pousses comme Olivia Rodrigo, 20 ans, (« driver license », « good 4 u » ou « vampire ») avec leurs chansons hyperpop, leurs hooks hyper-accrocheurs et leurs hymnes hyper-générationnels.
Or, dans le streaming, pas de guerre de générations non plus. Le compositeur estonien Arvo Pärt, du haut de ses 90 ans, s’impose aussi comme un multimillionnaire en streams. Son minimalisme sacré s’invite partout : des travellings cinématiques jusque dans les boucles TikTok. Logique alors qu’il devienne la star des playlists sur Spotify & Co. C’est l’antidote parfait pour notre époque bruitiste et la bande-son rêvée pour nos vies intérieures : comme si, finalement, cette expérience musicale avait le pouvoir non pas de capter notre attention, mais de la libérer.
Lire : “Arvo Pärt Reached Pop Star Status. Now He’s Ready to Rest”, Joshua Barone, New York Times, 11/09/25
Écouter : Spielgel Im Spiegel
|
Arvo Pärt lors de sa cérémonie de remise de la Légion d’honneur en 2011 |
L’ŒIL DU DOCTEUR JEQUIER
Qui défend encore l’intérêt général ?
|
Le politique et, pire encore, « l’État » pourtant plus neutre apparaissent disqualifiés aux yeux de l’opinion dans l’incarnation de l’intérêt général. Les chiffres sont édifiants selon la récente étude de l’Institut Bona fidé : 77% des Français jugent que les dirigeants politiques « agissent d’abord pour leurs intérêts particuliers », 23% seulement estimant à l’inverse qu’ils défendent prioritairement l’intérêt général. 76% (contre 24%) font le même constat pour les partis politiques et 61% (contre 39%) pour « l’État ». Le sentiment d’un politique et d’un État incarnant des intérêts particuliers plutôt que l’intérêt général est consensuel dans l’opinion. Il est majoritaire dans toutes les catégories d’âge, dans toutes les catégories sociales, dans tous les électorats, à la seule exception de celui de Renaissance.
On trouve dans ces chiffres l’un des symptômes les plus inquiétants de la crise du politique et de l’action publique. Quand le politique, et l’État, n’incarnent plus l’intérêt général aux yeux des citoyens, c’est le cœur du pacte démocratique qui est atteint. Si le politique national et l’État sont discrédités, la confiance demeure en revanche dans les acteurs publics locaux : 60% des Français estiment ainsi que les collectivités locales agissent d’abord en faveur de l’intérêt général, 40% étant d’un avis opposé.
Étude Institut Bona fidé, réalisée du 2 au 7 octobre auprès d’un échantillon représentatif de 1000 Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas.
|
Samuel Jequier est le président de l’Institut Bona fidé. Vous souhaitez analyser les tendances qui transforment la société ou votre secteur d’activité pour bâtir des stratégies de communication pertinentes ? Pour tout besoin d’études, quanti ou quali, n’hésitez pas à le consulter ! |
Merci de votre lecture ! Des idées ? Recommandations ? Critiques ?
Écrivez-nous en répondant directement à ce mail.
Pour vous abonner : c’est ici
Média conçu et rédigé par l’agence Bona fidé et sa Brigade des idées.
|
|