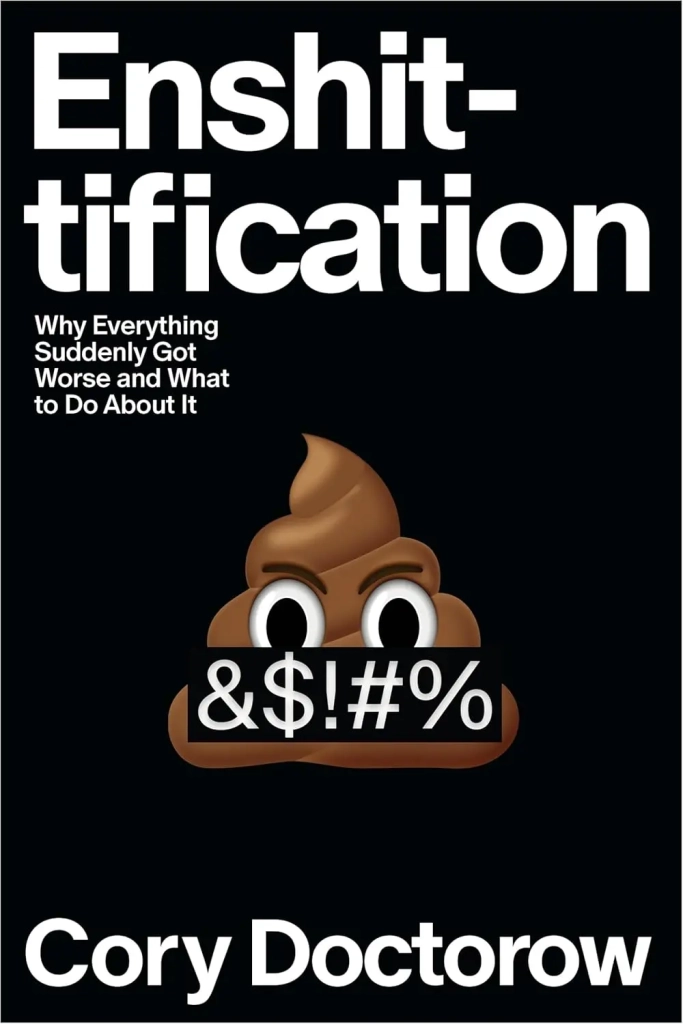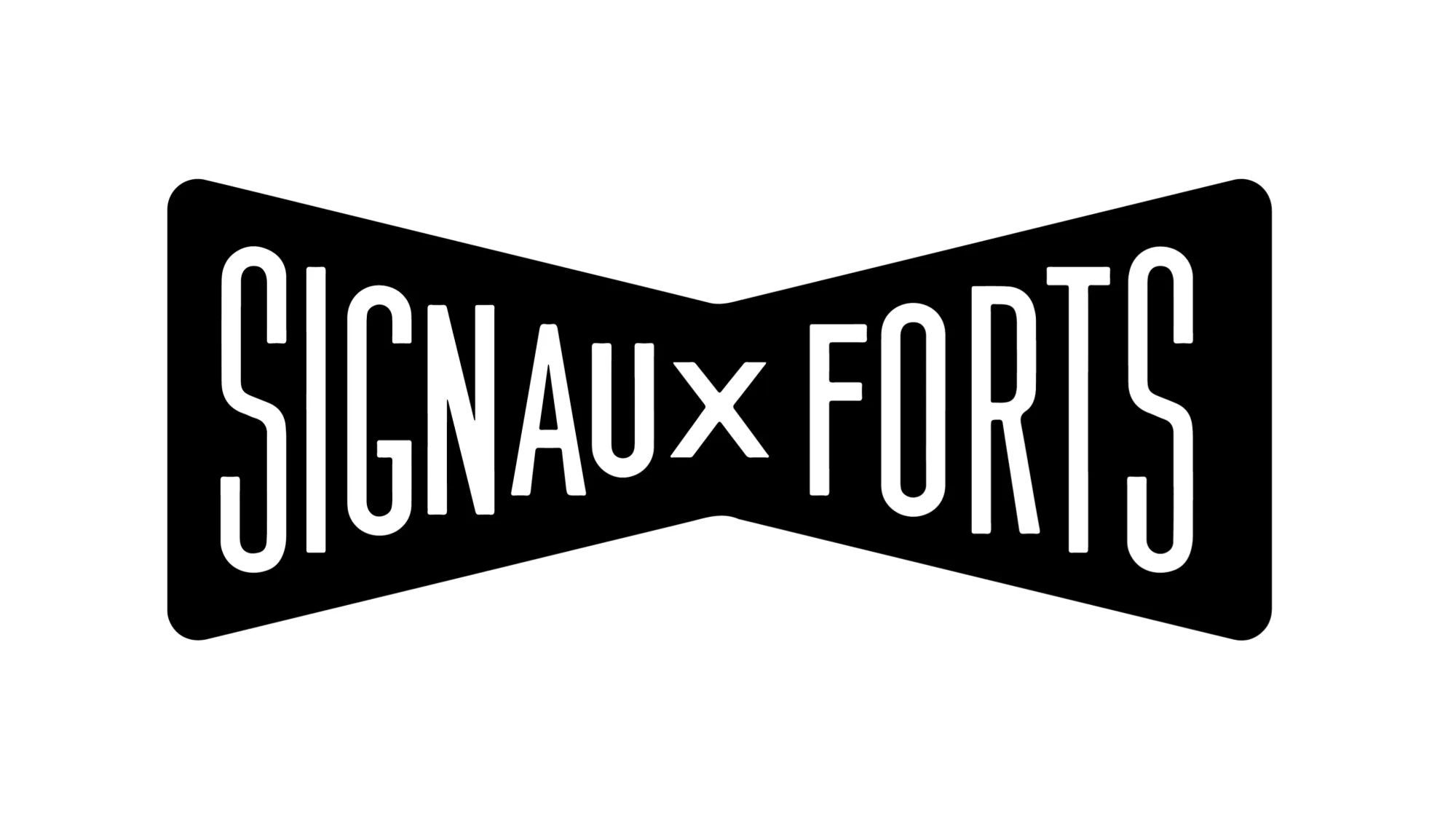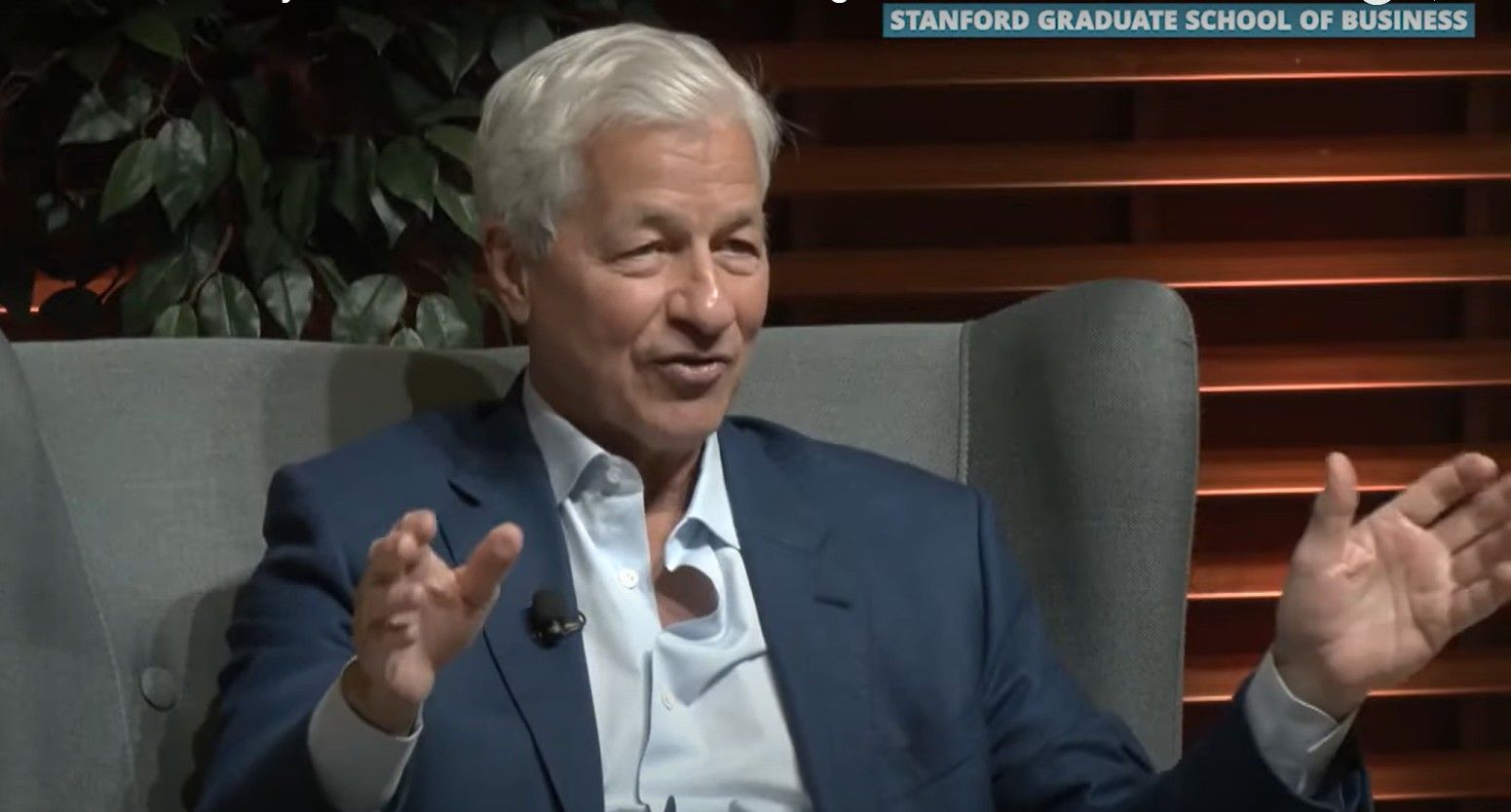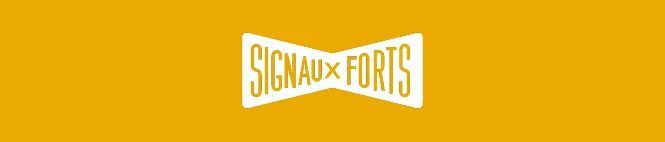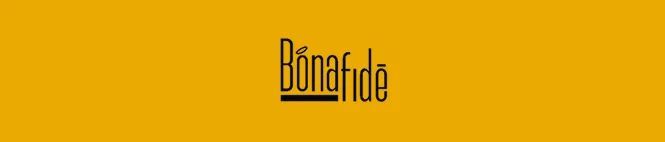Lisez ici ce que vous ne lirez pas ailleurs.
Signaux Forts est la newsletter de l’agence conseil Bona fidé.
Si vous prenez du plaisir à nous lire, n’hésitez pas à transférer cet e-mail et partagez-nous autour de vous ! 👯
|
LE TILT :
Le journal du hard
|
Et si nous étions entrés dans l’ère du « populism corporate » ? Et si la posture du commander-in-chief à la Maison Blanche déteignait et inspirait désormais les patrons des grandes entreprises américaines ? En tout cas, les signaux venus d’outre-Atlantique dessinent indéniablement le retour du Big boss et d’un « hard » management, que l’on croyait pourtant remisé depuis le Covid. S’il en fallait une illustration, la métamorphose de Mark Zuckerberg, de chef de start-up cool jouant au baby-foot avec ses collaborateurs à leader masculiniste regrettant d’être allé trop loin dans les politiques de diversité et d’inclusion, donnerait à elle seule l’ampleur de la contre-attaque en cours.
L’heure est bien aux États-Unis à la restauration d’un discours bien plus musclé, ferme et direct à l’égard des salariés et s’attaquant frontalement au télétravail, à la bureaucratie, à tout ce qui empêche, au fond, de faire plus avec moins. L’effet Doge version entreprise en quelque sorte. Alors, contre-attaque idéologique profonde ou posture conjoncturelle destinée à s’attirer les grâces du Président Trump ? Difficile de trancher mais les grands patrons américains font en tout cas feu de tout bois.
Ces dernières semaines, on a ainsi vu Jamie Dimon, patron de JP Morgan, devant ses salariés réunis à Colombus, s’emporter en multipliant les jurons contre le « fucking » télétravail, fustiger les « zoomeurs », fusiller son management trop complaisant et terminer en expliquant que la porte était grande ouverte pour ceux qui ne le suivaient pas. (« Personne n’est fichu de me répondre le vendredi » : la charge du patron de JP Morgan contre le télétravail | Les Echos). La bande-son de la réunion a opportunément fuité chez Reuters, comme s’il fallait montrer aux actionnaires et aux décideurs politiques que la transformation de la culture d’entreprise suivait celle de la gouvernance politique de la nation.
|
Jamie Dimon, CEO de la banque JP Morgan, lors d’une conférence sur le télétravail à l’école de commerce de Stanford |
C’est du moins l’hypothèse posée par Mike Ricci, associé chez Seven Letter, aux États-Unis. Brian Niccol, PDG de Starbucks, exhortant ses équipes « à en faire plus et à se dépasser », ou encore Andy Jassy, DG d’Amazon, dénonçant son management intermédiaire comme un « fief » nuisant à l’efficacité et ralentissant l’entreprise, ont complété le tableau. Et les actes suivent les discours. Honda a annoncé, par exemple, que ses employés américains devront être présents sur site au moins 80 % du temps de travail à partir d’octobre 2025, afin de s’adapter à un environnement commercial de plus en plus compétitif.
Retour forcé au bureau, recul des politiques de diversité et d’inclusion, injonctions brutales à faire plus… Les discours des dirigeants se durcissent, les avantages consentis pendant les années Covid sont revus à la baisse et l’exigence de productivité s’impose comme le nouveau totem, une nouvelle « Big Boss Era » semblant se répandre comme une traînée de poudre aux
États-Unis. Selon une étude récente d’Axios, près d’un dirigeant sur deux de grande entreprise souhaite augmenter prochainement le nombre de jours en présentiel.
Ce retour du management « tranchant » répond à la nouvelle donne politique américaine mais aussi aux bouleversements économiques récents. Ralentissement de la croissance, inflation persistante, intensification de la concurrence mondiale, crainte des licenciements économiques : le rapport de force, favorable aux salariés après le covid, se retourne en leur défaveur. Une inversion qui cristallise désormais un conflit autour du télétravail, perçu à la fois comme gain d’autonomie par les salariés et comme perte de contrôle par les dirigeants, et qui se retrouve ainsi au cœur des nouvelles luttes de pouvoir dans l’entreprise.
|
© École polytechnique – J.Barande |
Car le covid a aussi eu des effets de cliquets, modifiant fondamentalement le rapport au travail des nouvelles générations, autour d’une préférence pour le temps sur l’argent, d’une moindre attirance pour la carrière et d’attentes qualitatives bien plus intenses sur l’articulation et la conciliation des temps de vie professionnels et personnels. Autant d’aspirations vis-à-vis desquelles il n’est pas sûr que cette génération transige.
Zoomeurs contre boomers : telle pourrait bien être la lutte des classes revisitée façon tech des années qui viennent.
Vous avez tilté ?
|
Retrouver le grand continent de la démocratie |
Trump à l’Ouest. Poutine à l’Est. Erdogan au Sud. Orban au milieu de l’Europe. Les modèles populistes gagnent en influence et mènent désormais une croisade quasi-quotidienne contre nos démocraties libérales et leurs principes fondateurs.
Dans un large et dense article, «Gagner la guerre de l’information : vers la mobilisation générale des imaginaires démocratiques », publié au Grand Continent, Emmanuel Rivière, Xavier Bouvet et Benoît Thieulin décrivent en détail cette guerre de l’information, propagandiste et manipulatrice, déployée dans la « forêt sombre » du web et de ses algorithmes, et qui a quitté le stade de la complosphère pour devenir propagation généralisée.
Ils appellent les démocrates au sursaut et à sortir de leur état de « sidération ». Pas par le « débunk » des fakes news ou l’argumentation rationnelle. Mais par l’affect et l’attachement, dans un monde qui est celui de l’épuisement de la rationalité. Un sursaut qui passe en conséquence par la refonte et la revitalisation de nos narratifs et de nos récits pour remobiliser collectivement autour de l’imaginaire démocratique. En bref, le faire aimer à nouveau.
|
« Face à ce régime retors de fictionnalité, les armes de la critique factuelle sont largement impuissantes. Pour rendre ces récits inopérants, c’est sur le terrain de leur construction narrative qu’il faut se placer. La résistance de l’Estonie au feu de la désinformation russe ne s’explique pas seulement par ses dispositifs de sensibilisation aux médias et à l’influence (obligatoire dès la seconde), ni même par la seule vitalité de son écosystème médiatique. C’est d’abord la puissance d’un récit positif de souveraineté et de résistance, la perception des bénéfices de l’adhésion à l’Union et l’OTAN en 2004, qui désactive le narratif inverse. Or ce récit n’a pas été fabriqué pour la cause : il repose sur des éléments tangibles, une mémoire collective vivace et transmise dans nombre de familles». Défendre la démocratie par l’analyse et la raison, non ; la sauver en la promouvant par l’émotion, la mise en mouvement et la mobilisation, oui.
Avec un appel à toutes celles et tous ceux qui y tiennent : « la mobilisation générale est affaire d’imaginaires et d’affects plutôt que d’intérêts catégoriels. Sortons la démocratie en état de siège du discours transactionnel et déceptif dans laquelle nous l’avons laissée s’abîmer ces dernières décennies »
Gagner la guerre de l’information : vers la mobilisation générale des imaginaires démocratiques
Le Grand Continent
|
3 IDÉES ANTI PRÊT-À-PENSER®
|
Idée #1
Et si la phobie de l’IA révélait une peur de la facilité ?
Dans un article sur Every, Katie Parrott, autrice et content strategist, déplore que de nombreux rédacteurs freelance à travers le monde se voient refuser des contrats au motif que leur travail a été – souvent à tort – détecté comme généré par l’IA. Plus qu’une phobie pour la technologie, Parrott y décèle une peur pour la facilité, issue d’une culture du travail où la valeur est intimement associée à l’effort. Or l’IA remet en question cette vision : si le travail ne semble pas difficile, il est perçu comme moins légitime, même si le résultat est excellent. Et si cette politique « zéro IA » n’était souvent que le faux nez de notre obsession tenace pour la productivité mesurable héritée du taylorisme ? Appelons cela le stakIAnovisme.
AI Phobia Is Just Fear That ‘Easier’ Equals ‘Cheating’ – Katie Parrot, Every, 15 avril 2025
|
Idée #2
Et si le selfie n’était pas narcissique ?
Le selfie, symbole ultime du narcissisme contemporain ? Pas si vite, nous révèle un article illustré du New York Times qui révèle que la pratique du selfie est en réalité vieille de plusieurs siècles prenant racine dans la longue tradition des autoportraits artistiques : Jan van Eyck, Cindy Sherman ou Ai Weiwei ont tous utilisé le selfie pour exprimer une identité et porter une critique. Alors pourquoi le selfie d’aujourd’hui ne serait-il pas autre chose que la forme perfectionnée d’un nombrilisme superficiel ? Un outil de (re)prise de contrôle de son image, d’expression artistique, voire d’empowerment. À chaque jour selfie sa peine, eût dit Narcisse.
There’s More to Selfies Than Meets the Eye – Marisa Mazria Katz et Nato Thompson – The New York Times, 6 avril 2024
|
L’homme au turban rouge – Jan van Eyck, 1433. Considéré par certains comme le premier autoportrait indépendant © Sailko |
Idée #3
Non, Paul n’était pas le contraire de John ?
A priori, les Beatles, c’était simple : il y avait John Lennon, le rebelle avant-gardiste-écorché-vif-idéaliste et Paul McCartney, le doux-mélodiste-sentimental-un-tantinet-bourgeois… Que nenni nous raconte Ian Leslie dans un livre passionnant John and Paul – A Love Story in Songs. C’était bien plus subtil que cela : malgré leurs différences, on ne peut pas comprendre John sans Paul, ni Paul sans John. Ils étaient le miroir l’un de l’autre, le moteur mutuel de leur génie. Leslie souligne que leur relation faite de rivalité et d’admiration les a finalement rendus indissociables. Une « bromance » racontée au fil des chansons qui nous invite également à repenser la nature profonde de toute collaboration humaine : qu’est-ce qui la rend véritablement fructueuse ? Que l’on soit un Beatle ou non.
John and Paul – A Love Story in Songs – Ian Leslie (Faber & Faber)
|
L’OEIL DU DOCTEUR JEQUIER
|
« Je n’écoute plus, je ne regarde plus, je désactive mes notifications d’actualité, je ne peux plus les voir, ni les entendre… ». Après la défiance, la sécession. Dans toutes les enquêtes qualitatives réalisées par l’Institut Bona fidé depuis le début de l’année montait le signal faible d’une opinion se mettant de plus en plus délibérément en retrait et à l’écart d’un politique honni et décrié. Bien au-delà du « ne plus croire en la (et les) politique(s) », le mouvement est de s’en écarter et de s’en préserver définitivement. De faire sécession, en quelque sorte.
Le politologue Luc Rouban vient de quantifier cette tendance en travaillant sur les données d’opinion du baromètre de la confiance (Barometre confiance CEVIPOF Vague 16 fev 2025-v2_0.pdf) : sur un « indice de mise en distance du politique » de 0 à 5… 66% des Français se classent sur la partie maximale de l’indice. Une rupture en cours qui génère un problème inédit et majeur de communication pour les acteurs politiques.
La communication politique traditionnelle, passant notamment par les grands médias, n’est plus entendue ni reçue alors que se construit en parallèle sur les réseaux sociaux, WhatsApp et Instagram particulièrement, une communication sur la politique informelle, de pair à pair, « cachée » et échappant aux acteurs, aux observateurs comme aux outils de social listening. Une forme de « dark communication » de plus en plus libertarienne : 78% des Français considèrent aujourd’hui que « ce n’est pas parce qu’ils ont été élus que les hommes et femmes politique ont le droit de décider de leur vie ».
|
Samuel Jequier est le président de l’Institut Bona fidé. Vous souhaitez analyser les tendances qui transforment la société ou votre secteur d’activité pour bâtir des stratégies de communication pertinentes ? Pour tout besoin d’études, quanti ou quali, n’hésitez pas à le consulter ! |
Merci de votre lecture ! Des idées ? Recommandations ? Critiques ?
Écrivez-nous en répondant directement à ce mail.
Pour vous abonner : c’est ici
Média conçu et rédigé par l’agence Bona fidé et sa Brigade des idées.
|
|